- Cardiologie
- Chirurgie
- Chirurgie Cardio Vasculaire
- Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
- Dermatologie
- Diabétologie
- Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques
- Endocrinologie, diabétologie, nutrition
- Gynécologie
- Gynécologie obstétrique
- Hémophilie
- Hépato - Gastroentérologie
- Immunologie
- Infectiologie
- Médecine interne
Urologie
Par: Jean-Philippe HAYMANN, 1989 -PU-PH
Médicaments de la lithiase urinaire
Publié le : 25/09/2024
Le traitement médical des calculs consistant à éliminer les calculs in situ concerne principalement l’acide urique dont la solubilisation est obtenue par une alcalinisation prolongée.
Le traitement médical préventif de la maladie lithiasique intervient après une majoration de la diurèse et des conseils diététiques. L’alcalinisation en première intention concerne la cystinurie, l’acide urique et les acidoses tubulaires.
Le citrate de potassium et les thiazides peuvent être proposés en deuxième intention dans certainesmaladies lithiasiques actives.
Par: Valentine FORTÉ, 1989 -PU-PH
Médicaments de la lithiase urinaire
Publié le : 25/09/2024
Le traitement médical des calculs consistant à éliminer les calculs in situ concerne principalement l’acide urique dont la solubilisation est obtenue par une alcalinisation prolongée.
Le traitement médical préventif de la maladie lithiasique intervient après une majoration de la diurèse et des conseils diététiques. L’alcalinisation en première intention concerne la cystinurie, l’acide urique et les acidoses tubulaires.
Le citrate de potassium et les thiazides peuvent être proposés en deuxième intention dans certainesmaladies lithiasiques actives.
Par: Christophe ALMERAS, PH
La LEC après 45 ans d’expérience : où en sommes-nous ?
Publié le : 10/09/2024
La lithotritie extracorporelle (LEC) a été décrite pour la première fois en 1980, et représente le traitement instrumental mini invasif par excellence des calculs urinaires.
Son mécanisme d’action repose sur des ondes de choc focalisées sur une cible avec un repérage fluoroscopique et /ou échographique.
Pendant de nombreuses années, elle a demeuré le traitement de la majorité des calculs urinaires de l'adulte comme de l'enfant mais qu’en est-il avec le développement des lasers ?
Par: Olivier TRAXER, AIHP 1993 - PU-PH
Edito du dossier Lithiase urinaire
Publié le : 10/09/2024
La lithiase urinaire représente sans aucun doute la pathologie la plus indissociable de l’Urologie. Depuis toujours, elle est associée à l’histoire de l’humanité. Elle est connue dès l’antiquité et probablement même avant. Son nom fait référence aux « Calculi », petites pierres d’argile utilisées par les Sumériens pour réaliser leurs transactions financières. Le terme « lithiase » du grec ancien « Lithos » la pierre, doit toujours être utilisé au singulier car il désigne la maladie lithiasique urinaire. Le ou les calculs urinaires, eux, représentent les « petites pierres », manifestations cliniques de la maladie lithiasique.
Diététique et lithiase rénale : tout est dans l’assiette !
Publié le : 09/09/2024
La maladie lithiasique est un problème de santé publique, et touche 10 % de la population générale.
L’enquête alimentaire est la pierre angulaire de la prise en charge de nos patients lithiasiques. Elle permet
de repérer les « erreurs » diététiques et de proposer un rééquilibrage de l’alimentation afin de diminuer le
risque de récidive lithiasique de nos patients.
Pulvérisation LASER des calculs urinaires : différentes technologies et leurs résultats
Publié le : 07/09/2024
Le laser représente aujourd’hui l’outil de choix pour le traitement des calculs urinaires.
De nombreuses avancées technologiques ont remis en cause la suprématie du laser Holmium :YAG, avec notamment l’arrivée des lasers dopés au Thulium. Si le laser Thulium Fibré a démontré sa supériorité pour la pulvérisation des calculs, le Thulium :YAG pulsé est en cours d’évaluation. ■
LASER THULIUM Fibré et EndoUrologie : le nouveau-né au futur prometteur
Publié le : 01/12/2020
Réaliser aujourd'hui une activité d'EndoUrologie sans utiliser la technologie LASER est inimaginable. C'est Douglas E. JOHNSON en 1992 qui a été le premier à introduire le LASER Holmium:YAG en urologie. Sa publication originelle reste une référence, il y décrit tous les principes encore valables à ce jour.
Par: Marie-Lou LETOUCHE, Docteur Junior 2e année
Diététique et lithiase rénale : tout est dans l’assiette !
Publié le : 09/09/2024
La maladie lithiasique est un problème de santé publique, et touche 10 % de la population générale.
L’enquête alimentaire est la pierre angulaire de la prise en charge de nos patients lithiasiques. Elle permet
de repérer les « erreurs » diététiques et de proposer un rééquilibrage de l’alimentation afin de diminuer le
risque de récidive lithiasique de nos patients.
Par: Frédéric PANTHIER, 2014
Pulvérisation LASER des calculs urinaires : différentes technologies et leurs résultats
Publié le : 07/09/2024
Le laser représente aujourd’hui l’outil de choix pour le traitement des calculs urinaires.
De nombreuses avancées technologiques ont remis en cause la suprématie du laser Holmium :YAG, avec notamment l’arrivée des lasers dopés au Thulium. Si le laser Thulium Fibré a démontré sa supériorité pour la pulvérisation des calculs, le Thulium :YAG pulsé est en cours d’évaluation. ■
Par: Charles GAILLARD, PH
La chirurgie percutanée en France : évolutions, indications, innovations
Publié le : 06/09/2024
La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est une technique avancée pour traiter les calculs rénaux volumineux et complexes, souvent préférée en première intention selon les recommandations récentes. L'évolution des technologies, notamment la miniaturisation des instruments et les nouvelles techniques de lithotritie, a amélioré la sécurité et l'efficacité de cette intervention. La procédure, bien que plus invasive que les techniques endoscopiques rétrogrades, offre des solutions cruciales lorsque l'accès urinaire est compliqué par des malformations ou des antécédents chirurgicaux. Découvrez comment ces avancées transforment la prise en charge des calculs rénaux en France et dans le monde.
Par: Nadia ABID, Cheffe de service
La chirurgie percutanée en France : évolutions, indications, innovations
Publié le : 06/09/2024
La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est une technique avancée pour traiter les calculs rénaux volumineux et complexes, souvent préférée en première intention selon les recommandations récentes. L'évolution des technologies, notamment la miniaturisation des instruments et les nouvelles techniques de lithotritie, a amélioré la sécurité et l'efficacité de cette intervention. La procédure, bien que plus invasive que les techniques endoscopiques rétrogrades, offre des solutions cruciales lorsque l'accès urinaire est compliqué par des malformations ou des antécédents chirurgicaux. Découvrez comment ces avancées transforment la prise en charge des calculs rénaux en France et dans le monde.
Par: Franck BLADOU, PU-PH
Comment le système de santé au Canada fonctionne-t-il ?
Publié le : 01/12/2020
Après huit années d'exercice médical au Québec, voici quelques réflexions concernant le système de santé au Canada. Contrairement au système américain voisin, le Canada possède un système de santé public. Ses citoyens et résidents permanents sont couverts par l'assurance maladie canadienne avec prise en charge des consultations médicales et des hospitalisations.
Par: Hervé LANG, PU-PH
Salle hybride et Urologie
Publié le : 01/12/2020
La dénomination de salle hybride vient de l'industrie. La définition qu'on retrouve le plus souvent est : une salle hybride associe un bloc opératoire à un système d'imagerie perfectionné pour pratiquer des interventions de haute qualité alliant la chirurgie et la radiologie interventionnelle. Il s'agit d'un « concept fonctionnel ».
Par: Antoine FAIX,
Focus sur la dysfonction érectile
Publié le : 01/12/2020
La dysfonction érectile (DE) est un symptôme fréquent, notamment chez l'homme de plus de 40 ans ; il est un véritable symptôme sentinelle, permettant à tout médecin de déclencher un bilan spécifique, notamment en cas de facteurs de fragilité médicale et/ou psychologique. Elle est définie comme l'incapacité persistante ou répétée à obtenir et/ou à maintenir une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Une durée minimale de ce trouble de six mois, et sa présence dans plus de 75 % des cas sont nécessaires selon la classification du DSM-5.
Par: Yann NEUZILLET, PU-PH
L'immunothérapie dans le traitement des tumeurs de la vessie : une opportunité à ne pas manquer
Publié le : 01/12/2020
Les tumeurs de la vessie sont une pathologie dont la fréquence est à la fois élevée et croissante en raison de l'effet combiné du vieillissement de la population et de la persistance d'une prévalence importante du tabagisme en France. Les urologues sont actuellement en première ligne pour le diagnostic et le traitement de ces cancers dont 70 % des formes se traitent de manière conservatrice.
Par: Francois ROZET,
Les nouveaux médicaments du cancer de la prostate
Publié le : 01/12/2020
Les HTNG ont entrainé une modification importante des pratiques en montrant un bénéfice significatif en survie globale, une amélioration des symptômes et de la qualité de vie avec habituellement une bonne tolérance clinique et biologique. Dans tous les cas, le maintien de la SAd est nécessaire.
Par: Truong An NGUYEN,
Le traitement focal du cancer de la prostate où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
En cas de cancer prostatique localisé (CaP), différents traitements validés sont disponibles : prostatectomie radicale (PR), curiethérapie (BT), et radiothérapie externe (RTE). Les effets secondaires génito-urinaires et digestifs représentent un point-clé car uniquement une faible proportion de patients décèdera du CaP. Ces traitements offrent une forte probabilité de contrôle carcinologique mais avec un risque significatif d'effets secondaires selon le traitement (50 % d'impuissance, 5-10 % d'incontinence, 5-20 % de troubles digestifs). Ainsi, la surveillance active (AS) est devenue une option thérapeutique mais proposée essentiellement pour les CaP à faible risque.
Par: Caroline LUCAS,
Le traitement focal du cancer de la prostate où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
En cas de cancer prostatique localisé (CaP), différents traitements validés sont disponibles : prostatectomie radicale (PR), curiethérapie (BT), et radiothérapie externe (RTE). Les effets secondaires génito-urinaires et digestifs représentent un point-clé car uniquement une faible proportion de patients décèdera du CaP. Ces traitements offrent une forte probabilité de contrôle carcinologique mais avec un risque significatif d'effets secondaires selon le traitement (50 % d'impuissance, 5-10 % d'incontinence, 5-20 % de troubles digestifs). Ainsi, la surveillance active (AS) est devenue une option thérapeutique mais proposée essentiellement pour les CaP à faible risque.
Par: Antoine VALERI,
Le traitement focal du cancer de la prostate où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
En cas de cancer prostatique localisé (CaP), différents traitements validés sont disponibles : prostatectomie radicale (PR), curiethérapie (BT), et radiothérapie externe (RTE). Les effets secondaires génito-urinaires et digestifs représentent un point-clé car uniquement une faible proportion de patients décèdera du CaP. Ces traitements offrent une forte probabilité de contrôle carcinologique mais avec un risque significatif d'effets secondaires selon le traitement (50 % d'impuissance, 5-10 % d'incontinence, 5-20 % de troubles digestifs). Ainsi, la surveillance active (AS) est devenue une option thérapeutique mais proposée essentiellement pour les CaP à faible risque.
Par: Franck BRUYERE, PU-PH
Antibioprophylaxie et biopsies de la prostate
Publié le : 01/12/2020
Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme. Néanmoins il fait l'objet de polémiques quant au dépistage et au traitement des formes localisées. L'Association Française d'Urologie (AFU) recommande un dépistage par dosage du PSA et un toucher rectal tous les 2 à 4 ans entre 50 et 75 ans et dès 45 ans en cas d'antécédent familial du 1er degré. Dans ce contexte, nombreux sont les hommes ayant besoin d'une biopsie de la prostate.
Par: Georges FOURNIER, PU-PH
HBP quel laser ?
Publié le : 01/12/2020
Le traitement des troubles mictionnels liés à l'hypertrophie bénigne prostatique est en premier lieu médical. Le traitement chirurgical arrive en deuxième intention en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit ou en cas de complications. Le courant électrique, mono ou bipolaire était le standard dans la prise en charge endoscopique jusqu'à un volume de prostate approximatif de 80 cm3. Au-delà, pour les très grosses prostates, la chirurgie de l'adénome était réalisée par voie ouverte abdominale, voire coelioscopique avec ou sans assistance robotique. L''avènement des lasers a révolutionné ces dernières années l'approche du traitement de l'adénome prostatique.
Par: Richard MALLET,
HBP quel laser ?
Publié le : 01/12/2020
Le traitement des troubles mictionnels liés à l'hypertrophie bénigne prostatique est en premier lieu médical. Le traitement chirurgical arrive en deuxième intention en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit ou en cas de complications. Le courant électrique, mono ou bipolaire était le standard dans la prise en charge endoscopique jusqu'à un volume de prostate approximatif de 80 cm3. Au-delà, pour les très grosses prostates, la chirurgie de l'adénome était réalisée par voie ouverte abdominale, voire coelioscopique avec ou sans assistance robotique. L''avènement des lasers a révolutionné ces dernières années l'approche du traitement de l'adénome prostatique.
Par: Eric LECHEVALLIER,
La réforme des études médicales du premier cycle et deuxième cycle
Publié le : 01/12/2020
2020-2021 est une année importante, bien que de transition, pour l'enseignement des études médicales. Cette année universitaire voit l'application de la réforme des études médicales concernant les 3 cycles. Dans cet article nous aborderons les aspects de la réforme des 1er et 2e cycles des études de santé.
Par: Luc CORMIER, PU-PH
Présentation du dossier UROLOGIE N°102
Publié le : 01/12/2020
C'est un grand plaisir de coordonner un fascicule de la revue de l'Internat de Paris (RIP) consacré à l'urologie. Lors de ces dernières années il m'a semblé que différents domaines devaient être présentés et que l'on me pardonne les oublis éventuels ou une priorisation partiale de ces sujets parmi d'autres. Surtout je remercie vivement les collègues mis à contribution.
Par: Ugo PINAR, AIHP 2014
La réforme du Troisième cycle en urologie à Paris, où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
La réforme du troisième cycle des études médicales a été initiée il y a quatre ans avec pour but premier l'amélioration de la formation des internes. Qu'en est-il en pratique ? Quelles sont les particularités de cette réforme pour les internes qui choisissent de débuter une formation en urologie en Ile-de-France ?
Par: Juliette COTTE, AIHP 2016
La réforme du Troisième cycle en urologie à Paris, où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
La réforme du troisième cycle des études médicales a été initiée il y a quatre ans avec pour but premier l'amélioration de la formation des internes. Qu'en est-il en pratique ? Quelles sont les particularités de cette réforme pour les internes qui choisissent de débuter une formation en urologie en Ile-de-France ?
Par: Morgan ROUPRET, AIHP 1999 - PU-PH
La réforme du Troisième cycle en urologie à Paris, où en sommes-nous ?
Publié le : 01/12/2020
La réforme du troisième cycle des études médicales a été initiée il y a quatre ans avec pour but premier l'amélioration de la formation des internes. Qu'en est-il en pratique ? Quelles sont les particularités de cette réforme pour les internes qui choisissent de débuter une formation en urologie en Ile-de-France ?
Inventons sans tarder l'Urologie de demain
Publié le : 01/06/2017
Dans ce numéro de l'Internat de Paris, la nouvelle génération des urologues parisiens nous présentent et anticipent avec brio les nouveautés et les innovations dans le champ de leur domaine d'excellence de l'urologie.
Par: Véronique PHé,
Les infections urinaires dans la sclérose en plaques
Publié le : 01/06/2017
Les infections urinaires (IU) sont un problème fréquent dans la sclérose en plaques (SEP). La prévalence des IU dans la SEP varie entre 13% et 80% selon les cohortes étudiées [1]. Cette variation de chiffres de prévalence peut également être expliquée par l'absence de consensus dans la définition de l'IU dans les études ainsi que dans les critères de diagnostic d'une IU chez les patients ayant une maladie neurologique et en particulier une SEP [1].
Par: François AUDENET, AIHP 2006
Utiliser les progrès de la génétique pour une médecine de précision en onco-urologie
Publié le : 01/06/2017
D'après le National Institutes of Health (NHI), la médecine de précision est une approche émergeante pour la prévention et le traitement des maladies prenant en considération la variabilité individuelle des gènes, de l'environnement et du mode de vie de chaque individu.
Par: Evanguelos XYLINAS, AIHP 1990
La récidive vésicale après traitement d'une tumeur de la voie excrétrice urinaire supérieure
Publié le : 01/06/2017
Les Tumeurs de la Voie Excrétrice urinaire Supérieure (TVES) regroupent les processus néoplasiques qui affectent la muqueuse de l'arbre urinaire depuis les calices jusqu'à l'uretère distal. Elles appartiennent à la famille des tumeurs urothéliales dans la grande majorité des cas et partagent certains traits communs avec les tumeurs de vessie. Cependant, elles en diffèrent par de nombreux aspects. Pour des raisons anatomiques, l'exploration endoscopique des voies urinaires supérieures est plus difficile que pour la vessie et du fait d'une paroi plus fine (en particulier pour les localisations urétérales), mais aussi sans doute pour des raisons moléculaires partiellement inconnues, leur pronostic est grevé.
Par: Jean-Nicolas CORNU,
Nouveautés dans la prise en charge de l'hyperplasie bénigne de la prostate et de l'hyperactivité vésicale
Publié le : 01/06/2017
L'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est une pathologie associée au vieillissement extrêmement fréquente chez l'homme de plus de 50 ans. Grande pourvoyeuse de symptômes du bas appareil urinaire, l'HBP a connu au cours des dix dernières années une révolution en termes d'approche diagnostique et thérapeutique, à la faveur d'un changement de paradigme qui a consacré le concept de Male LUTS.
Par: Idir OUZAID,
Evolutions récentes dans la prise en charge chirurgicale et médicale du cancer du rein
Publié le : 01/06/2017
Depuis les années 1970, l'incidence du cancer du rein (RCC) est en augmentation aussi bien en France, en Europe qu'en Amérique du nord. Le traitement chirurgical reste le traitement de choix des cancers localisés. Cette prise en charge a vu émerger la néphrectomie partielle (NP) qui a pour objectifs la préservation néphrotique d'une part et la réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire inhérente à la néphrectomie totale (NT) d'autre part.
Par: Alexandra MASSON-LECOMTE,
Actualités dans la détection endoscopique des tumeurs de vessie
Publié le : 01/06/2017
La découverte d'une tumeur de vessie, suite, le plus souvent, à un épisode d'hématurie macroscopique, doit conduire à la réalisation d'une cystoscopie sous anesthésie générale. Cette dernière permettra l'exérèse endoscopique de la tumeur.
Par: Bernard DEBRE, (AIHP 1969) Service d\'Urologie - Hôpital Cochin
Le PSA (antigène spécifique de la prostate) comme marqueur de détection et facteur pronostique du cancer de la prostate
Publié le : 01/12/2009
Une caractéristique fondamentale sépare les outils de dépistage des tests diagnostiques. Un test de dépistage positif n'affirme pas qu'une personne est malade, mais indique seulement que cette personne a un risque élevé de l'être. Ces outils du dépistage sont utilisés sur une grande échelle d'individus, et ont donc des impératifs à respecter. Leur utilisation doit être facile, rapide, et reproductible. Ces outils doivent être accessibles, et leur coût acceptable. Jusqu'en 1986, le clinicien ne disposait que du toucher rectal pour dépister le cancer de la prostate. Cet examen a ensuite été secondé par le dosage sérique du PSA (Prostate Specific Antigen). La sensibilité et la spécificité de ce marqueur ont été améliorées grâce à l'utilisation du PSA libre, de la vélocité du PSA et de la densité du PSA. En plus de sa valeur diagnostique, le taux de PSA est corrélé à la progression du cancer et constitue donc l'outil principal du suivi des patients. Enfin, le PSA a prouvé sa valeur en tant que marqueur pronostique, car il est associé de manière indépendante à la survie sans récidive après traitement, à la survie spécifique et à la survie globale.
Par: Laurent BOCCON GIBOD, AIHP 1963 - PU-PH
Cancer localisé de la prostate de faible risque : la place actuelle de la surveillance active avec traitement retardé
Publié le : 01/12/2009
Il peut paraître extrêmement surprenant de voir accolé les motscancer de la prostate et surveillance avec traitement retardé et pourtant la surveillance avec mise en oeuvre retardée d'un traitement en cas de signe de progression est un choix parfaitement raisonnable qui peut être proposé aux patients atteints d'un cancer prostatique localisé de faible risque. En effet, la pratique extensive du dosage de l'antigène prostatique spécifique (PSA), associée à la réalisation des biopsies prostatiques comportant un nombre croissant de prélèvements, réalisé pour des valeurs de PSA de plus en plus basses (parfois jusqu'à 2.5 ng par ml...), a conduit ces dernières années à une augmentation spectaculaire du nombre de cancers prostatiques diagnostiqués puisque le risque d'être connu porteur d'un cancer de la prostate est passé de 1/11 en 1980 à 1/6 en 2009 sans que soit observée une réduction parallèle de la mortalité par cancer. Cette augmentation spectaculaire de l'incidence du cancer de la prostate porte essentiellement sur les cancers prostatiques de faible risque, pour lesquels le bénéfice du traitement à visée curative en terme d'années de vie gagnées, est probablement marginal au regard des effets secondaires significatifs du traitement, qu'il s'agisse des troubles de la continence et des troubles de la sexualité après prostatectomie totale, ou des séquelles vésicales ou rectales du traitement par les agents physiques (curiethérapie, radiothérapie externe).
Par: Virginie MARCHAND , (AIHP 2003) Institut Curie. Paris
La curiéthérapie du cancer prostatique
Publié le : 01/12/2009
La curiethérapie est la technique d'irradiation qui consiste à mettre en place des sources radioactives au contact ou à l'intérieur même des tumeurs. On distingue donc : - la plésiocuriethérapie, où les sources sont au contact du tissu à irradier, en profitant de l'existence de cavités naturelles : elle peut être endocavitaire (curiethérapie utéro-vaginale) ou endoluminale (curiethérapie endobronchique ou endo-oesophagienne). - La curiethérapie interstitielle ou endocuriethérapie, où les sources sont implantées à l'intérieur de la tumeur, comme par exemple dans une tumeur de langue, du sein, de la prostate. L'urologie et la gynécologie se partagent aujourd'hui la majorité des indications de curiethérapie. Nous nous concentrons ici sur la curiethérapie de la prostate.
Par: Jean-Marc COSSET, (AIHP 1970) Institut Curie. Paris
La curiéthérapie du cancer prostatique
Publié le : 01/12/2009
La curiethérapie est la technique d'irradiation qui consiste à mettre en place des sources radioactives au contact ou à l'intérieur même des tumeurs. On distingue donc : - la plésiocuriethérapie, où les sources sont au contact du tissu à irradier, en profitant de l'existence de cavités naturelles : elle peut être endocavitaire (curiethérapie utéro-vaginale) ou endoluminale (curiethérapie endobronchique ou endo-oesophagienne). - La curiethérapie interstitielle ou endocuriethérapie, où les sources sont implantées à l'intérieur de la tumeur, comme par exemple dans une tumeur de langue, du sein, de la prostate. L'urologie et la gynécologie se partagent aujourd'hui la majorité des indications de curiethérapie. Nous nous concentrons ici sur la curiethérapie de la prostate.
Par: René YIOU, AIHP 1992
Traitement de l'incontinence urinaire par injection des cellules précurseurs musculaires
Publié le : 01/12/2009
L'incontinence urinaire d'effort est une pathologie fréquente et invalidante. L'origine de cette pathologie chez la femme peut être une défaillance des mécanismes de soutien de l'urètre et/ou une insuffisance sphinctérienne urétrale (ISU). Chez l'homme, l'incontinence urinaire survient en général au décours d'une chirurgie prostatique avec lésion accidentelle du sphincter strié urétral. L'incontinence urinaire par ISU est généralement très invalidante et son traitement reste assez mal codifié. La mise en place d'un sphincter urinaire artificiel reste le traitement de référence en cas d'ISU sévère et permet la disparition des fuites urinaires dans plus de 85% des cas ; cependant, l'utilisation de ce dispositif constitue une contrainte permanente pour les patients et peut être à l'origine de complications telles qu'une érosion urétrale ou une infection du matériel ou bien nécessiter des ré interventions pour dysfonctionnement. D'autres types de traitements sont en cours d'évaluation tels que l'implantation de ballons ajustables ou les bandelettes urétrales compressives, mais il s'agit encore une fois de matériaux étrangers dont les effets à long terme sur l'urètre sont mal connus. Par ailleurs, ils ne permettent pas de rétablir une physiologie vésico-sphinctérienne normale.
Par: Nicolas BARRY DE LONGCHAMPS, AIHP 2002
Le PSA (antigène spécifique de la prostate) comme marqueur de détection et facteur pronostique du cancer de la prostate
Publié le : 01/12/2009
Une caractéristique fondamentale sépare les outils de dépistage des tests diagnostiques. Un test de dépistage positif n'affirme pas qu'une personne est malade, mais indique seulement que cette personne a un risque élevé de l'être. Ces outils du dépistage sont utilisés sur une grande échelle d'individus, et ont donc des impératifs à respecter. Leur utilisation doit être facile, rapide, et reproductible. Ces outils doivent être accessibles, et leur coût acceptable. Jusqu'en 1986, le clinicien ne disposait que du toucher rectal pour dépister le cancer de la prostate. Cet examen a ensuite été secondé par le dosage sérique du PSA (Prostate Specific Antigen). La sensibilité et la spécificité de ce marqueur ont été améliorées grâce à l'utilisation du PSA libre, de la vélocité du PSA et de la densité du PSA. En plus de sa valeur diagnostique, le taux de PSA est corrélé à la progression du cancer et constitue donc l'outil principal du suivi des patients. Enfin, le PSA a prouvé sa valeur en tant que marqueur pronostique, car il est associé de manière indépendante à la survie sans récidive après traitement, à la survie spécifique et à la survie globale.
Par: Michaël PEYROMAURE, (AIHP 1995) Service d\'Urologie - Hôpital Cochin
Le PSA (antigène spécifique de la prostate) comme marqueur de détection et facteur pronostique du cancer de la prostate
Publié le : 01/12/2009
Une caractéristique fondamentale sépare les outils de dépistage des tests diagnostiques. Un test de dépistage positif n'affirme pas qu'une personne est malade, mais indique seulement que cette personne a un risque élevé de l'être. Ces outils du dépistage sont utilisés sur une grande échelle d'individus, et ont donc des impératifs à respecter. Leur utilisation doit être facile, rapide, et reproductible. Ces outils doivent être accessibles, et leur coût acceptable. Jusqu'en 1986, le clinicien ne disposait que du toucher rectal pour dépister le cancer de la prostate. Cet examen a ensuite été secondé par le dosage sérique du PSA (Prostate Specific Antigen). La sensibilité et la spécificité de ce marqueur ont été améliorées grâce à l'utilisation du PSA libre, de la vélocité du PSA et de la densité du PSA. En plus de sa valeur diagnostique, le taux de PSA est corrélé à la progression du cancer et constitue donc l'outil principal du suivi des patients. Enfin, le PSA a prouvé sa valeur en tant que marqueur pronostique, car il est associé de manière indépendante à la survie sans récidive après traitement, à la survie spécifique et à la survie globale.
Par: Richard Olivier FOURCADE, AIHP 1969
Quarante ans d'évolution de la pensée urologique en matière de cancer de prostate
Publié le : 01/12/2009
Le cancer de la prostate ne s'est véritablement individualisé de l'hypertrophie bénigne qu'au début du 20ème siècle où il était alors - rarement - traité par une intervention de prostatectomie totale périnéale avec des résultats carcinologiques et fonctionnels que l'on peut décrire au mieux comme "aléatoires". Un véritable saut qualitatif survient en 1941 avec la publication par Charles HUGGINS de Chicago de sa découverte de l'hormonodépendance de ce cancer : Il montre que, chez la souris, le cancer prostatique s'arrête de progresser lorsqu'on réalise une orchidectomie bilatérale tandis qu'on assiste à sa reprise évolutive si l'on réintroduit de la testostérone. Il recevra le Prix Nobel en 1966 pour cette découverte et le concept qui en découle du traitement du cancer de la prostate chez l'homme par suppression androgénique.
Par: François DESGRANDCHAMPS, (AIHP 1984) Hôpital St Louis - Paris
Prise en charge de l'HBP : Evolution ou révolution ?
Publié le : 01/12/2009
Jusqu'à il y a environ 10 ans rien n'avait changé depuis le XIXème siècle concernant la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate : on opérait en cas de complication et l'on traitait par des médicaments pour les symptômes sans que ce traitement médical n'ait d'interférence connue avec l'histoire naturelle de la maladie.
Par: Bertrand DUFOUR, (AIHP 1961)
Tumeurs de véssie
Publié le : 01/12/2009
C'est la deuxième tumeur maligne urologique avec 10.000 nouveaux cas par en en France. Définition : est dite tumeur maligne celle qui pénètre le muscle c'est-à-dire > pT2 dans la classification TNM 1997. La classification de consensus OMS/ISUP de 1998 recommandait de ne plus utiliser la terme de tumeurs superficielles et de considérer qu'une tumeur est infiltrante dés qu'elle franchit la lame basale et envahit le chorion (pT1). Il existe ainsi une confusion et il est dommage et pour les médecins et pour les malades d'intituler "carcinomes" - même de bas grade - des tumeurs tout à fait bénignes, autrefois (et encore aujourd'hui) dénommées "polypes".
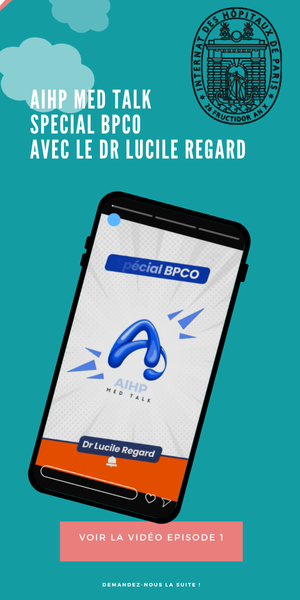


.png)




_1.png)



























